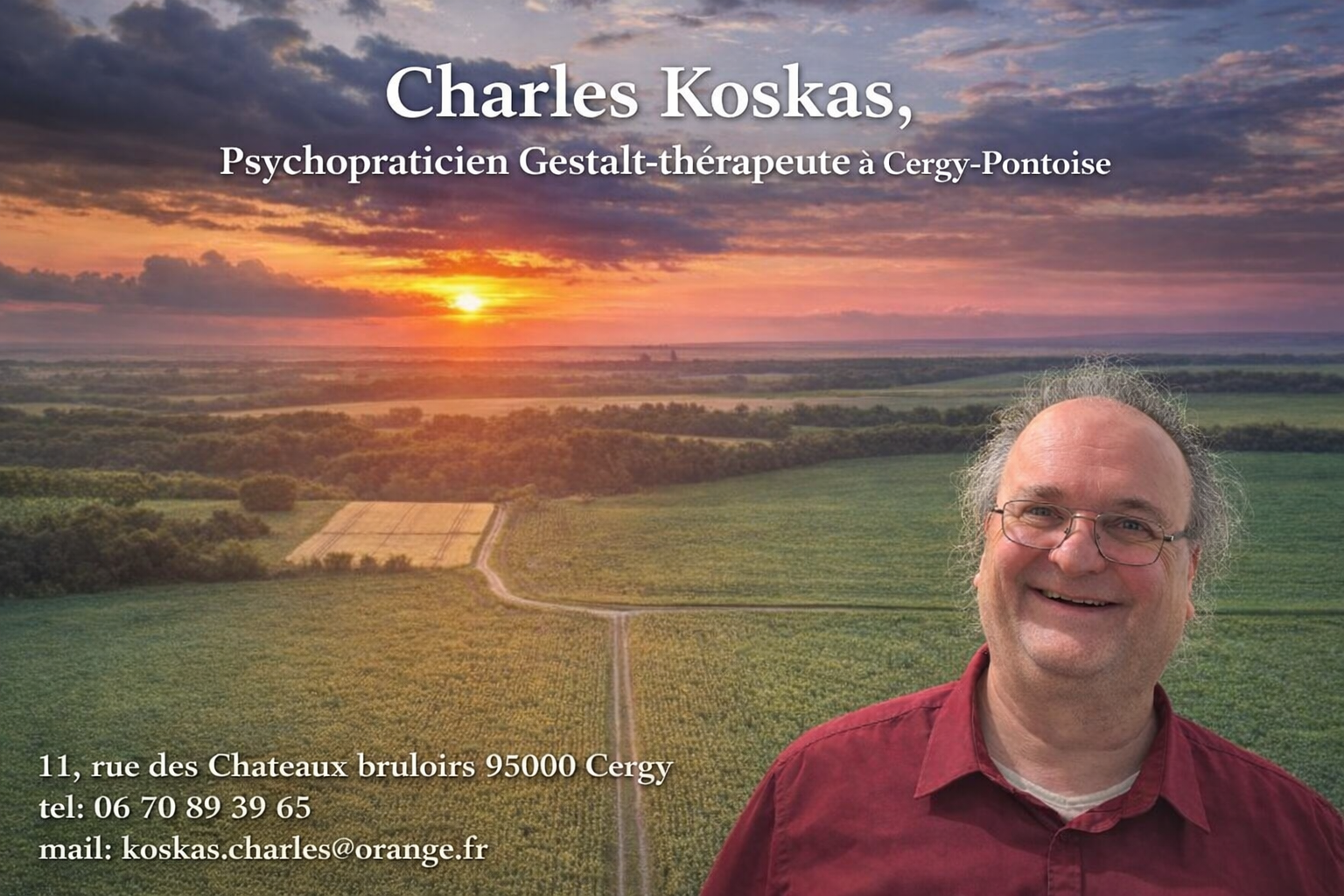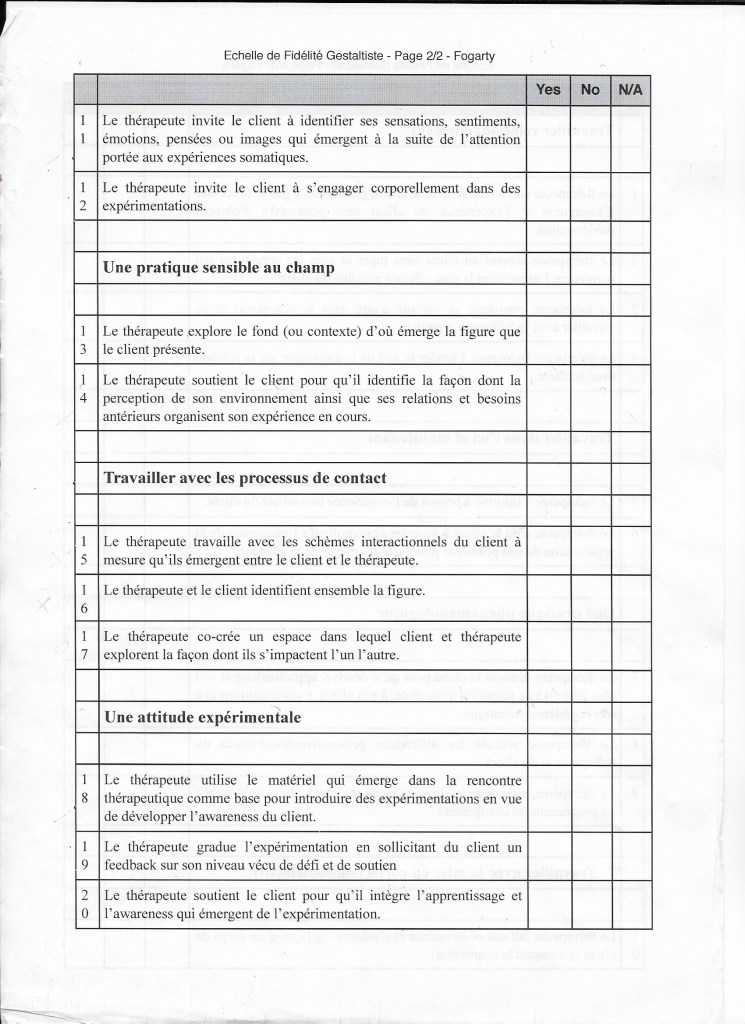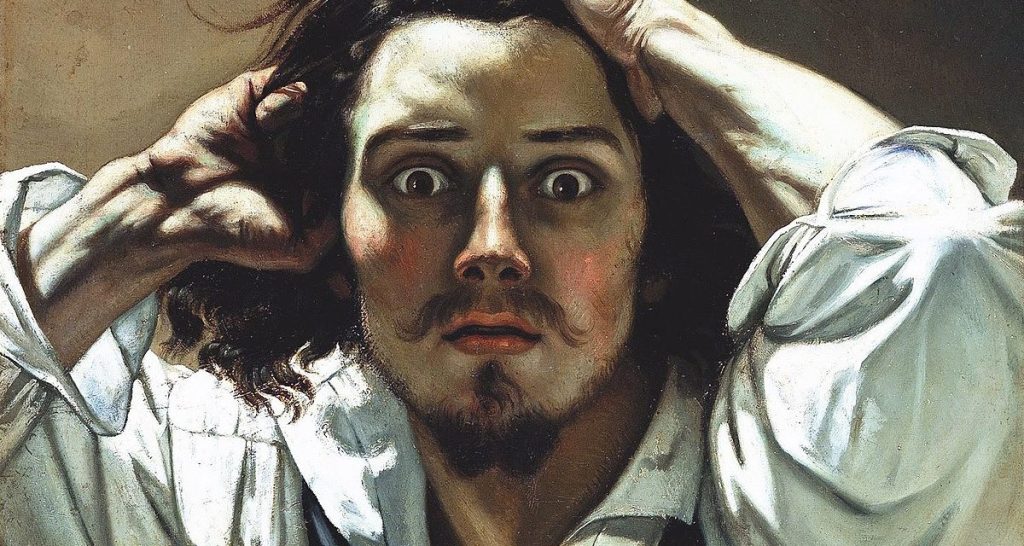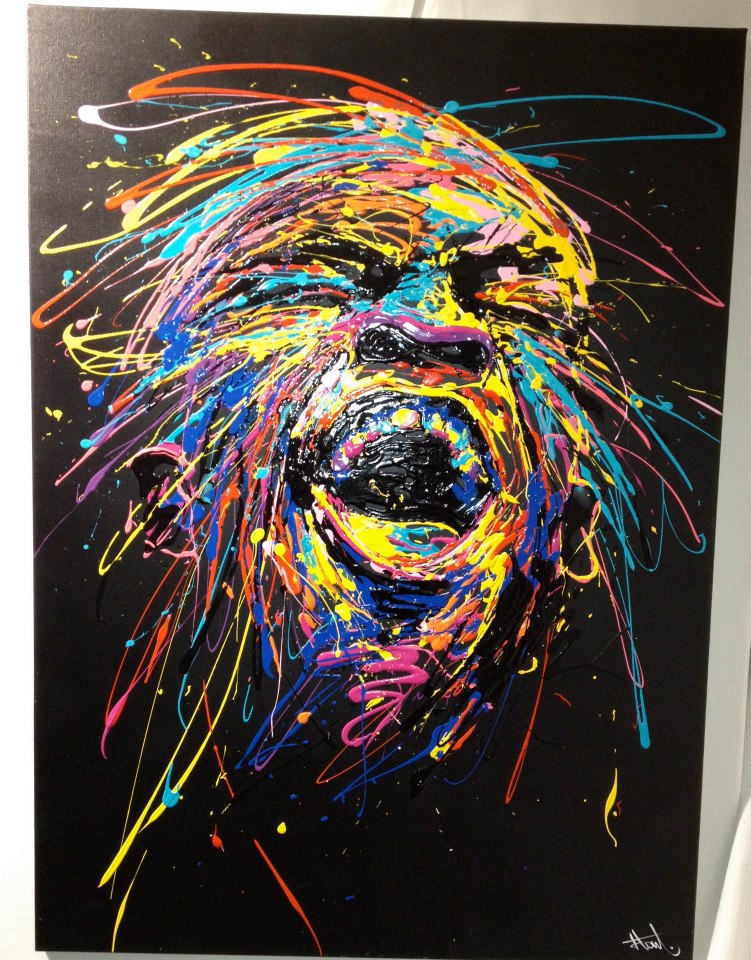Via le blog de Astrid Dusendschön , par Romina Rinaldi, paru en juillet 2017, original ici
Le corps n’est pas au service de l’esprit : il en fait partie. Telle fut la thèse défendue par Francisco Varela, théoricien de la « cognition incarnée » et pionnier du rapprochement entre bouddhisme et neurosciences.

Chercheur prolifique, Francisco Varela est reconnu pour son travail dans des domaines tels que la biologie, les sciences cognitives, les mathématiques et l’intelligence artificielle. En une quinzaine de livres et pas moins de 200 articles, il lègue une œuvre innovante et diversifiée.
La psychologie de l’Univers
Né en 1946 au Chili, il vit jusqu’à ses 6 ans dans un petit village perché de la cordillère des Andes. Son père déménage ensuite à Santiago où il passe le reste de son enfance. Il y reçoit une éducation classique au lycée qui fera émerger chez lui le goût de la littérature classique et de la philosophie.
Dès le début de son parcours universitaire, Varela est considéré comme un élève « à part ». Alors qu’à l’époque, biologie et sciences cognitives sont parfaitement dissociées, Varela, lui, s’interroge sur la biologie de la connaissance. Comment le cerveau fonctionne et produit des savoirs. Plus tard, lorsqu’il avait à se présenter, il se décrivait volontiers comme un « biologiste de l’esprit ».
Il reçoit sa licence en biologie à l’université du Chili en 1967 et change de continent pour obtenir son doctorat à Harvard. Il revient ensuite au Chili afin de poursuivre ses recherches avec son mentor, Humberto Maturana. Varela aimait souvent raconter l’histoire du jour où, encore étudiant, il débarqua dans le bureau de H. Maturana en lui annonçant son désir « d’étudier la psyché de l’Univers ». Loin d’être déconcerté, H. Maturana lui aurait répondu : « Mon garçon, vous avez frappé à la bonne porte ! »
Entre 1970 et 1973, H. Maturana et Varela mettront au point leur théorie de l’autopoïèse. La question sur laquelle se construit cette théorie est ambitieuse : qu’est-ce qui définit un organisme vivant ? Dans la préface de la seconde édition du livre De máquinas y seres vivos (Autopoiesis and Cognition), H. Maturana décrit le contexte dans lequel lui et Varela se sont attelés à la tâche : « Dans les années 1960, c’était une question sans réponse. Les biologistes ne la considéraient même pas à vrai dire. Ils esquivaient en arguant que d’autres connaissances étaient nécessaires ou se contentaient de lister les propriétés et caractéristiques des êtres vivants ; sans pouvoir dire à quel moment cette liste serait complète. »
Au terme de plusieurs années de recherche, les deux chercheurs aboutissent à la conclusion que ce qui caractérise les organismes vivants est leur capacité d’autocréation. En simplifiant, on peut décrire le système autopoïétique (du grec auto, soi et poiesis, création, génération) comme un réseau de composants dont l’organisation est invariable, mais dont les parties se régénèrent et se transforment continuellement à travers leurs interactions avec le réseau qui les a produites. L’organisme vivant est donc un système qui comprend une description de lui-même servant à la reproduction. Il est autonome (l’ADN produit les protéines qui produisent l’ARN) et agit de façon circulaire avec son environnement dans une perspective de préservation ou d’adaptation (l’ADN peut muter suite à des contraintes de l’environnement).
Lorsque Varela et H. Maturana transmettent cette théorie à de prestigieuses revues comme Science ou Nature, leur article est rejeté. Avec l’aide du physicien Heinz von Foerster, ils précisent leur propos dans un nouvel article. Celui-ci paraîtra dans une revue plus modeste. Malgré ces débuts difficiles, le concept rencontre l’intérêt d’autres biologistes et se trouve récupéré par des disciplines comme les mathématiques, la sociologie ou les sciences cognitives.
Après le coup d’État militaire de septembre 1973, Varela se réfugie aux États-Unis avant de rejoindre le Chili en 1980. La dernière étape de sa carrière, il la passera à l’Institut des neurosciences et au Centre de recherche en épistémologie appliquée de Paris. En 1988, il est nommé directeur de recherche ; position qu’il occupera jusqu’à la fin de sa vie. Alors qu’il reçoit le diagnostic d’hépatite C au début des années 1990 et subit une greffe hépatique en 1998, ses années passées en France restent parmi les plus productives de sa carrière. Il y décède en 2001, à l’âge de 54 ans, entouré de sa famille.
Ramener l’humain au centre du vivant
Au milieu des années 1980, Varela a su ramener la biologie à la table des disciplines travaillant sur la cognition. Dans un article intitulé « Francisco Varela : des systèmes et des boucles », Benoît Leblanc, maître de conférences à l’Institut polytechnique de Bordeaux, décrit cette transition depuis des sciences cognitives obsédées par l’intelligence artificielle ou réduites aux sciences du cerveau.
Pour rappel, l’objet des sciences cognitives est de comprendre comment l’être humain traite de l’information, stocke des connaissances et les produit. Entre les années 1970 et 1980, les courants dominant cette discipline sont le cognitivisme computationnel et le connexionnisme. Pour ces deux courants, le cerveau reçoit de l’information perceptive de l’environnement (input), la traite (boîte noire) et génère une réponse (output).
Dans le cognitivisme computationnel, c’est l’ordinateur qui sert de modèle pour la « boîte noire ». Le connexionnisme apportera des nuances à ces théories en introduisant l’idée que pour comprendre l’esprit humain, il faut s’intéresser au cerveau et non aux machines. L’esprit serait plutôt constitué d’une série de petites machines (les neurones) qui doivent travailler ensemble de façon cohérente (réseaux de neurones). Au début des années 1990, les neurosciences participent à l’essor des théories connexionnistes. Le cerveau devient directement observable quand il traite de l’information. À cette époque donc, le monde scientifique considère que la cognition se résume au cerveau et qu’on peut la décrire comme une recette de cuisine. Varela, lui, pense que la connaissance n’existe que dans l’expérience et que l’expérience passe par le corps tout entier. Il ouvre une nouvelle voie : celle de la cognition incarnée.
Énaction et cognition incarnée
L’idée n’est pas neuve. Au début du 20e siècle, des philosophes comme Maurice Merleau-Ponty ou Edmund Husserl soulignaient déjà l’importance de l’expérience dans la création des connaissances. Varela n’ayant jamais fermé la porte à la philosophie dans ses recherches, il n’est pas surprenant d’y voir apparaître ce genre d’influence.
À partir de ses travaux sur l’interaction des organismes vivants avec l’environnement et la régénération perpétuelle (systèmes autopoïétiques), Varela propose une nouvelle théorie de la cognition : l’énaction ou cognition incarnée. Celle-ci remet en cause l’idée du connexionnisme et du cognitivisme computationnel que le monde existe sur base de règles fixes, indépendamment de la perception qu’en a le sujet.
L’idée générale est à la fois simple et complexe : les fonctions corporelles (sensorielles et motrices) sont des constituants à part entière de l’esprit et non pas des systèmes secondaires au service de l’esprit. Autrement dit, le corps fait partie intégrante de la cognition : nous pensons et ressentons les choses en fonction de ce qui se passe dans nos systèmes sensoriels et moteurs. Par exemple, prenons une fonction cognitive comme le langage et le fait de comprendre un mot comme « couteau ». « Couteau » est un concept qu’on peut décrire de façon abstraite (ex. est un ustensile de cuisine, coupe, est en acier…), mais qui contient aussi les informations sensorielles et motrices liées à son utilisation (ex. attraper le couteau, coordonner le mouvement et le regard pour éviter que le couteau ne touche l’ongle du pouce, etc.). Et quand on comprend le mot « couteau », on intègre ces informations qui viennent du corps entier et de l’environnement. La cognition n’est pas une réplique passive de la réalité extérieure. Elle l’intègre et en dépend. Le corps et l’esprit ne font plus qu’un !
Conscience et subjectivité
Par ailleurs, la cognition ne peut être comprise sans faire référence au corps humain. En ce sens, la cognition incarnée se rapproche du connexionnisme. Pour Varela toutefois, le connexionnisme reste insuffisant pour expliquer comment les réseaux de neurones donnent du sens à l’information qu’ils reçoivent. Pour que le cerveau produise du sens, il faut qu’il possède une histoire, qu’il agisse sur son environnement et qu’il observe les variations de celui-ci. Un réseau de neurones (connexionniste) dépourvu d’environnement tournerait bien, mais dans le vide, traitant de l’information sans pouvoir lui donner du sens.
La neurophénoménologie représente l’aboutissement des travaux de Varela. Très longtemps, le sujet de la conscience est resté tabou pour le monde scientifique (y compris pour les sciences cognitives). On acceptait vaguement que la philosophie ou la psychanalyse en fassent leur sujet d’étude, mais il aurait été inenvisageable de l’intégrer à des paradigmes de recherche. Comment aurait-on pu se le figurer ? L’expérience consciente est par essence subjective. Et le principe de la recherche scientifique est de rester objectif. L’époque où même les émotions n’étaient pas un sujet d’étude adéquat en psychologie cognitive n’est pas si lointaine.
La neurophénoménologie
Pourtant, une forte continuité entre le corps et l’esprit se dégage des travaux de Varela. C’est pourquoi, dans ses dernières années de recherche, il s’attellera à développer la neurophénoménologie, un courant entre les neurosciences et la philosophie de l’expérience. L’objectif est alors de traiter la problématique de la conscience. À savoir comment et pourquoi les processus physiologiques donnent naissance à l’expérience subjective et consciente.
Aussi admiré que controversé, Varela aura passé sa vie en transition entre l’approche scientifique occidentale et la sagesse de l’Est. Malgré sa rigueur scientifique, on lui reprocha souvent d’énoncer des théories floues et difficiles à mettre en œuvre. À l’heure actuelle, le changement de paradigme qu’il souhaitait pour la science n’en est encore qu’à ses prémices.
L’héritage de Varela
Pourtant, Varela aura su élargir le concept même de la science et ouvrir le dialogue entre les disciplines scientifiques. Le concept de cognition incarnée reste notamment très prisé par le monde de la recherche. Depuis les années 2000, plus de 15 000 livres et articles seraient parus à ce sujet. Au-delà de ces publications, le Mind and Life Institute remet annuellement un prix de 15 000 dollars à des chercheurs s’inscrivant dans la vision de la science proposée par Varela.
Enfin, certains thèmes de recherche qui paraissent évidents de nos jours n’auraient peut-être pas émergé sans des chercheurs comme Varela. Parlerait-on alors de pleine conscience dans les revues scientifiques les plus cotées ? Comprendrait-on la façon dont nos émotions influencent notre mémoire ? Verrait-on une jeune génération de chercheurs proposer des théories comme la neuroergonomie qui tente de créer des espaces et environnements plus proches de notre fonctionnement cérébral ? Dans son parcours, Varela n’aura peut-être pas découvert toute la vérité, mais il aura indéniablement ouvert bien des portes.
Pour aller plus loin…
• Le Cercle créateur. Écrits (1976-2001)
Francisco Varela, Seuil, 2017.
• « Life and mind : From autopoeisis to neurophenomenology.
A tribute to Francisco Varela »
Evan thompson, Phenomenology and the Cognitives Sciences, vol. III, n° 4, décembre 2004